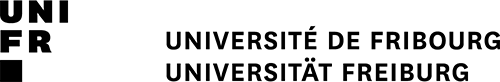Publié le 21.12.2023
Le mot du Doyen, Joachim Negel - SA 2023/III
Chères et chers membres de la Faculté de théologie
Chères amies et chers amis
Si le temps de l’Avent est un temps d’attente du Sauveur, un temps où l’on s’étire avec un désir ardent, où l’on prend patience, voire où l’on se laisse mûrir, car on ne peut rien forcer, alors cette année, l’Avent n’a pas été grand-chose. Tous les sept ans, le quatrième dimanche de l’Avent tombe le 24 décembre, et tous les sept ans, le temps de l’Avent ne dure donc que trois semaines. Et c’est déjà Noël, un véritable accouchement précipité. Qu’est-ce que cela peut nous dire ?
Tout d’abord, certainement ceci : la brièveté de la période de l’Avent de cette année (bien qu’elle nous soit imposée par le calendrier) est en quelque sorte le reflet de notre incapacité à la lenteur et à la patience. La modernité produit un véritable état d’urgence ; nous vivons en permanence en mode accéléré. Un seul exemple : combien de temps passait-on à écrire des lettres il y a encore une génération ? On se demandait quand, à qui et pourquoi on écrivait des lettres. On écrivait des lettres d’affaires quand c’était nécessaire, sinon on n’en écrivait pas ; et pour les lettres d’amitié ou de parenté, écrites à la main avec une plume sur du papier, on prenait son temps, et ce parce qu’il faut du temps pour écrire une bonne lettre. Mais si, dans le même temps durant lequel j’écris une lettre, je peux rédiger cinq e-mails, je suis sous pression, car tous les e-mails que j’envoie doublent ou triplent le trafic de communication – en d’autres termes, mon temps diminue, subjectivement, alors que je fais beaucoup plus de choses dans le même temps. Mais en même temps, il se vide : je suis constamment en train de tourner et je sais de moins en moins quoi faire de moi.
Le sociologue Hartmut Rosa, d’Iéna, a analysé ces contextes avec force ; il parle d’un mode d’augmentation permanent dans lequel nous vivons. La croissance et l’accélération sont en quelque sorte le système nerveux de la modernité capitaliste[1]. Bien que les moyens techniques nous déchargent de mille tâches et que nous gagnions ainsi toujours plus de temps, nous avons toujours moins de temps. Tout le monde connaît ce phénomène paradoxal : plus le monde nous offre de possibilités, moins il en reste pour chaque personne ou chaque chose. Les listes de choses à faire ne cessent de s’allonger, bien que (ou peut-être justement parce que) nous travaillions toujours plus. Et cela ne va pas sans laisser de traces. La société multi-options nous dépasse. La folie de l’optimisation nous rend fous ; il faut constamment évaluer les choses, il y a toujours de la marge (« Comment avez-vous vécu votre voyage d’aujourd’hui ? », dit l’autocollant sur le siège dans le train, avec en dessous le code-barres à scanner : « Où pouvons-nous nous améliorer ? Dites-le-nous ! »). Les spécialistes des sciences cognitives parlent de surstimulation à tous les niveaux : chez le barman, il n’y a pas trois sortes de café, mais trente-deux ; au supermarché, on trouve vingt-sept sortes de yaourts au lieu de trois. Alors qu’il y a cinquante ans, il n’y avait que deux chaînes de télévision (début de l’émission à 15 heures, fin à 22 heures), aujourd’hui, les « news » se disputent notre attention toutes les minutes – il faut être « à la page », celui qui n’est pas à la page est « out ». Les médecins parlent du « burnout » comme d’une maladie de notre temps.
Un véritable Avent serait salutaire ! Un temps de silence, d’attente, d’espoir et de prière. Un temps d’une véritable « Langeweile », de longue patience, de halte.
Le problème est que l’individu ne peut pas changer grand-chose à ce contexte. La manière dont nous gérons le temps, les structures temporelles, les modèles temporels et les attentes à tenir sont ancrés dans le collectif. L’Université, en tant que machine à savoir de la modernité capitaliste, n’y échappe pas plus que sa Faculté de théologie. Même chez nous, théologien-ne-s, qui devrions pourtant savoir ce qu’est « l’Avent », une conférence chasse l’autre, un congrès succède à un autre, une demande de recherche remplace la suivante. L’acquisition de « fonds tiers », voilà le salut. En revanche, celui qui reste tranquillement assis dans sa chambre pour étudier (« Reste dans ton kellion », avertissaient les Pères du désert), celui qui se concentre sur la lecture et la réflexion sur Dieu, et peut-être même, en faisant ainsi, rentre dans la prière (quel anachronisme !), appartient à un monde qui n’existe plus. Peut-on s’étonner que nous ne croyions plus guère en Dieu ? Nous ne vivons plus non plus dans l’Avent. Et sans l’Avent, sans la longue durée (« lange Weile »), pas de venue de Dieu dans notre chair.
Comment répondre à cela ? Peut-être en rappelant que toute vie naît d’un silence entendu en solitaire et partagé. C’est ainsi : personne ne s’est engendré lui-même, personne ne s’est enfanté lui-même, nous nous retrouvons, nous nous éveillons à nous-mêmes, nous sommes confiés à nous-mêmes, nous mûrissons lentement dans la vie. Nous ne sommes jamais les auteurs de nous-mêmes, nous nous sommes (pré)donnés, nous nous recevons. Tout comme le sol maternel accueille la semence, la fait germer et la libère en la faisant fructifier (cf. Is 55,10s), il en va de même pour la vie dans son ensemble : la vie est Avent, arrivée venant d’un silence immémorial.
Et c’est ainsi que nous arrivons tout de même à la fête de Noël, à la naissance du Verbe divin dans le Christ, qui veut se faire homme en nous : « Alors que le silence profond enveloppait l’univers et que la nuit était parvenue jusqu’au milieu, ta parole toute-puissante jaillit du ciel [...]. L’essence de toute la création fut remodelée ; elle obéit à tes préceptes, afin que tes enfants soient préservés indemnes » (Sg 18,14s ; 19,6). Un texte magnifique du livre juif de la Sagesse, rédigé en grec à Alexandrie quelques décennies avant le changement d’époque, vers 80-30 av. J.-C. Un savoir immémorial se manifeste ici : le silence semble être le début de tout, le berceau et l’accomplissement de toute réalité, l’englobant. N’est-ce pas vraiment le cas ? Dans le silence, nous devinons à quel point nous sommes seuls, profondément uniques. Mais c’est justement dans cette unicité que nous nous découvrons comme nous étant promis, encouragés, confiés. Et si nous nous posions ces questions de l’Avent que nous ne laissons que rarement venir à nous, parce que nous ne pouvons pas y répondre par nos propres moyens : « D’où suis-je ? », « Où vais-je ? », « Dieu existe-t-il ? », « Qu’en est-il des morts ? », « Qu’en est-il de moi ? », « Qu’est-ce que tout cela signifie ? », « Qui suis-je au juste ? ».
Aucune sociologie, psychologie, économie ou politique ne peut nous donner la réponse à des questions comme celles-ci, et la philosophie et la théologie sont elles aussi désespérément dépassées par celles-ci. Car ce sont des questions auxquelles personne ne peut répondre par lui-même – à moins que sa réponse ne soit la résonance de cette parole immémoriale dont il est dit qu’elle a « jailli du ciel au milieu de la nuit, alors que le silence profond enveloppait l’univers », pour se faire homme en nous comme elle s’est faite homme en Jésus, le Christ.
Peut-être existe-t-il tout de même, ce silence et cette discrétion dans lesquels résonne ce qu’aucun homme ne peut se dire à lui-même. Je vous souhaite la bénédiction de ce Logos qui a eu l’audace de devenir infans.
Joachim Negel, Doyen
[1] Hartmut Rosa, Accélération. Une critique sociale du temps, traduit de l’allemand par Sasha Zilberfarb, La Découverte, Paris, 2010. Id., Aliénation et accélération. Vers une critique de la modernité, traduit de l’anglais par Thomas Chaumon, La Découverte, Paris, 2012.